
La plupart des trousses de secours en mer sont conçues pour des bobos, pas pour sauver une vie. La clé est un changement radical de mentalité.
- Pensez en « syndromes » (hémorragie, malaise) et non en « produits » (pansements, aspirine).
- Organisez votre matériel en modules d’intervention pour gagner des secondes précieuses.
Recommandation : Adoptez la logique MIST (Mécanisme, Blessures, Signes, Traitement) pour structurer vos actions et vos appels aux secours.
En tant que chef de bord, vous avez une trousse de secours. C’est bien. C’est même obligatoire. Mais ressemble-t-elle à une annexe de votre pharmacie domestique, remplie de pansements pour égratignures et d’aspirine ? Si c’est le cas, elle est inutile face à une véritable urgence en mer. Une coupure profonde sur une manille, une brûlure au moteur, un hameçon planté dans une main ou un malaise brutal à plusieurs milles des côtes ne se gèrent pas avec du paracétamol et un désinfectant classique. L’environnement marin est hostile : l’humidité compromet les pansements, le sel aggrave les plaies et l’isolement transforme le moindre incident en crise potentielle.
L’erreur fondamentale est de penser en termes de « produits ». La solution n’est pas d’accumuler une collection de boîtes, mais d’adopter la mentalité d’un secouriste. Il ne s’agit pas de savoir quel médicament donner, mais quel syndrome traiter. Cette approche, que j’appelle la logique syndromique, change tout. Elle vous force à raisonner en protocoles d’intervention : que faire face à une hémorragie, un trouble de la conscience, une détresse thermique ? C’est ce changement de paradigme qui transforme une simple boîte en un véritable poste de secours avancé, capable de stabiliser une victime en attendant une évacuation.
Cet article n’est pas une liste de courses. C’est un guide opérationnel pour restructurer votre pensée et votre matériel. Nous allons déconstruire les mythes, établir des protocoles clairs pour les accidents les plus courants et vous donner les clés pour devenir le premier maillon efficace de la chaîne de survie en mer. L’objectif n’est pas de vous transformer en médecin, mais de vous donner les moyens de préserver une vie pendant les minutes cruciales qui précèdent l’arrivée des secours professionnels.
Cet article vous guidera à travers les étapes essentielles pour transformer votre approche de la sécurité en mer. Le sommaire ci-dessous vous permettra de naviguer entre les différents aspects de cette préparation cruciale, du matériel indispensable aux gestes qui sauvent.
Sommaire : Révolutionner votre trousse de secours pour le large
- La trousse réglementaire ne suffit pas : les 10 produits à ajouter qui font la différence
- La trousse de secours en mer : ce qui est vraiment utile quand on est loin de tout
- Coupure, hameçon, brûlure : les 3 tutoriels de premiers secours que tout marin doit maîtriser
- Le corps lâche : comment reconnaître et réagir face à un malaise en mer
- Les « monstres » marins qui n’en sont pas : la vérité sur les animaux qui vous font peur
- Une trousse de secours bien rangée est une urgence à moitié gérée
- Vous n’êtes pas seul : comment bénéficier d’une consultation avec un médecin urgentiste 24h/24
- Votre équipement de sécurité : des objets inutiles qui prennent la poussière ou vos meilleurs alliés en cas de crise ?
La trousse réglementaire ne suffit pas : les 10 produits à ajouter qui font la différence
La trousse de secours réglementaire, définie par la Division 240, est conçue pour la petite bobologie. Elle constitue une base légale, mais en aucun cas une garantie de sécurité face à un accident sérieux. Penser qu’elle suffit est une illusion dangereuse, surtout sur les petites embarcations où les risques sont statistiquement en hausse. Le bilan annuel du SNOSAN révèle une augmentation de 46,42% des opérations de sauvetage sur les navires de moins de 8m entre 2010 et 2020. Il est donc impératif de compléter votre dotation en adoptant une logique d’intervention face aux syndromes les plus probables.
Voici 10 ajouts essentiels qui transforment votre trousse en un outil de stabilisation efficace, organisés par modules d’intervention :
- Module Diagnostic : Un oxymètre de pouls et un tensiomètre électronique. Ces outils non invasifs permettent de quantifier l’état de la victime et de transmettre un bilan chiffré et objectif au CCMM (Centre de Consultation Médicale Maritime).
- Module Hémorragie Sévère : Un garrot tourniquet tactique et des pansements hémostatiques (imbibés d’une substance qui accélère la coagulation). Face à une hémorragie artérielle, un pansement classique est inutile ; ces deux éléments sont les seuls capables d’arrêter un saignement massif.
- Module Brûlure : Des gels et compresses hydrocolloïdes spécifiques pour brûlures. Ils isolent la plaie de l’air salin, soulagent la douleur et préviennent l’infection dans un environnement humide.
- Module Douleur & Allergie : Des antalgiques de palier 2 (sur prescription de votre médecin) et des corticoïdes injectables. Une douleur insupportable peut entraîner un état de choc.
- Module Immobilisation : Une attelle thermoformable (type SAM Splint) et des bandes de contention cohésives. Pour stabiliser une fracture ou une entorse et limiter la douleur et les lésions secondaires.
- Module Communication : Une fiche MIST (Mécanisme, Injury/Blessures, Signes vitaux, Treatment/Traitement) plastifiée et un feutre indélébile pour noter le bilan avant d’appeler les secours.
Ces ajouts ne sont pas des gadgets. Chacun répond à un scénario de crise spécifique et vous donne les moyens d’agir de manière structurée plutôt que de subir la situation.
La trousse de secours en mer : ce qui est vraiment utile quand on est loin de tout
Posséder le meilleur matériel du monde ne sert à rien si vous ne savez pas vous en servir. En mer, loin de tout, l’outil le plus précieux n’est pas dans votre trousse de secours, il est entre vos deux oreilles : c’est votre compétence. L’improvisation n’a pas sa place dans l’urgence. La panique et le stress inhibent la réflexion. Seule une formation préalable, avec des gestes répétés et mémorisés, permet d’agir de manière quasi automatique et efficace.
La formation aux premiers secours est donc l’investissement le plus rentable pour votre sécurité. Le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) est le minimum absolu pour tout chef de bord. Comme le souligne la Société Nationale de Sauvetage en Mer, cette formation est la clé pour une action citoyenne efficace :
La formation PSC1 permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.
Cette journée de formation vous apprendra à évaluer une situation, à protéger, à alerter et à réaliser les gestes qui sauvent en attendant les secours. L’argument du coût n’est pas recevable face à l’enjeu. Une formation PSC1 coûte en moyenne entre 40 et 100 euros selon les organismes. C’est le prix d’un bon repas au restaurant, mais l’enjeu est de pouvoir sauver la vie d’un équipier, d’un proche, ou la vôtre. C’est un prérequis non négociable pour quiconque prend la responsabilité d’un équipage en mer. Idéalement, l’ensemble de l’équipage régulier devrait être formé.
Au-delà du PSC1, des formations plus spécifiques au milieu maritime (PSE1/2, formations médicales hauturières) permettent d’aller plus loin. Mais sans cette base, votre trousse de secours, aussi complète soit-elle, n’est qu’une collection d’objets inutiles.
Coupure, hameçon, brûlure : les 3 tutoriels de premiers secours que tout marin doit maîtriser
En situation d’urgence, la théorie s’efface devant l’action. Connaître les protocoles pour les 3 blessures traumatiques les plus courantes et dangereuses en bateau est vital. La panique est votre pire ennemi ; la procédure est votre meilleur allié.
1. Gérer une coupure profonde avec hémorragie :
Oubliez le petit pansement. Si le sang gicle ou s’écoule en nappe, vous faites face à une hémorragie grave. Votre objectif unique est d’arrêter le saignement.
- Compression directe : Appuyez fermement sur la plaie avec des compresses propres (ou n’importe quel linge propre à portée de main). Si possible, allongez la victime et surélevez le membre atteint.
- Le pansement compressif : Si la compression manuelle ne suffit pas, réalisez un pansement compressif. Placez une épaisseur de compresses sur la plaie et enroulez très fermement une bande autour du membre pour maintenir une pression constante.
- Le garrot tourniquet (en dernier recours) : Si le saignement est incontrôlable et met la vie en danger (membre qui continue de saigner abondamment malgré la compression), le garrot est la seule option. Le protocole est strict : positionnez-le bien en amont de la plaie, serrez la boucle, tournez la poignée jusqu’à l’arrêt total du saignement, fixez la poignée et, surtout, notez impérativement l’heure de pose sur le garrot ou le front de la victime. C’est un acte grave mais qui sauve une vie.

L’application d’un pansement compressif, comme visible sur cette image, requiert de la force et de la méthode pour être efficace. La pression doit être suffisante pour juguler le flux sanguin en profondeur.
2. Retirer un hameçon planté :
C’est un accident très spécifique au nautisme. Ne tirez jamais en arrière, les ardillons déchireraient les tissus. La technique la plus simple et efficace est celle « à la ficelle » :
- Plaquez la hampe de l’hameçon contre la peau.
- Passez un fil solide (fil de pêche, fil dentaire) dans la courbure de l’hameçon.
- D’un coup sec et rapide, tirez sur le fil dans l’axe de la hampe. L’hameçon sortira par où il est entré, sans plus de dégâts.
- Désinfectez abondamment la plaie et vérifiez la vaccination antitétanique de la victime.
3. Traiter une brûlure (thermique ou chimique) :
Le premier geste est toujours de refroidir, mais jamais avec de l’eau de mer directement sur une brûlure étendue, à cause du risque d’infection. Utilisez de l’eau douce et propre pendant au moins 15 minutes. Ensuite, ne percez jamais les cloques. Appliquez une compresse hydrogel spécifique pour brûlures, qui calmera la douleur et protégera la plaie, puis un bandage lâche. Surveillez les signes d’infection dans les jours qui suivent.
Le corps lâche : comment reconnaître et réagir face à un malaise en mer
Les traumatismes sont visibles, mais les menaces internes sont plus insidieuses. Un équipier qui devient pâle, confus ou faible doit déclencher une alerte immédiate. En mer, les causes de malaise sont multiples et il est crucial de savoir différencier les signes pour apporter la bonne première réponse. Le mal de mer, ou naupathie, est fréquent et touche près de 25% de la population, mais il peut masquer des problèmes plus graves.
Votre rôle n’est pas de poser un diagnostic, mais d’identifier un syndrome et d’agir en conséquence pour stabiliser la situation. Trois malaises spécifiques au contexte maritime doivent être connus : l’hypothermie, le coup de chaleur et l’hypoglycémie. Ils présentent des signes distincts qui appellent des actions opposées.
Le tableau suivant synthétise les signes caractéristiques et la première action à mener pour ces trois urgences vitales. Une erreur d’appréciation (par exemple, réchauffer activement une victime de coup de chaleur) peut être fatale.
| Type de malaise | Signes caractéristiques | Première action |
|---|---|---|
| Hypothermie | Tremblements incontrôlables (ou absence de tremblements si grave), confusion, paroles incohérentes, peau froide et pâle. | Isoler du froid et du vent, retirer les vêtements mouillés, envelopper dans une couverture de survie (réchauffement passif). Ne jamais frotter ni donner d’alcool. |
| Coup de chaleur | Peau très chaude, rouge et sèche (absence de transpiration), maux de tête violents, confusion, perte de connaissance. | Refroidissement immédiat : mettre à l’ombre, asperger d’eau, ventiler. Hydrater avec de l’eau fraîche par petites gorgées si la personne est consciente. |
| Hypoglycémie | Sueurs abondantes (même par temps frais), tremblements, faiblesse soudaine, pâleur, faim intense, anxiété, confusion. | Administration de sucre rapide si la personne est consciente (morceau de sucre, boisson sucrée, gel de glucose). Suivi par un sucre lent (biscuit, pain). |
Dans tous les cas de malaise avec altération de la conscience, la procédure est la même :
- Sécuriser : Allonger la personne en Position Latérale de Sécurité (PLS) si elle est inconsciente et qu’elle respire, pour protéger ses voies aériennes.
- Évaluer : Prendre les constantes vitales (pouls, fréquence respiratoire, saturation en oxygène si vous avez un oxymètre).
- Alerter : Contacter le CCMM par VHF (canal 16) ou par téléphone pour un avis médical. Transmettez un bilan clair et chiffré.
Ne sous-estimez jamais un malaise en mer. L’environnement peut rapidement faire basculer une situation bénigne en drame.
Les « monstres » marins qui n’en sont pas : la vérité sur les animaux qui vous font peur
La peur de la faune marine est souvent alimentée par des mythes et des idées reçues. S’il est vrai que certaines créatures peuvent infliger des blessures douloureuses, connaître les bons protocoles permet de dédramatiser la situation et d’apporter une réponse efficace. La plupart des « remèdes de grand-mère » sont au mieux inefficaces, au pire dangereux.
Le plus grand danger n’est pas l’animal lui-même, mais la réaction inadaptée de la victime ou de son entourage. Voici la vérité sur les envenimations les plus courantes et les gestes validés à appliquer, loin des légendes urbaines.
Ce tableau comparatif démonte les mythes les plus tenaces et présente les protocoles validés par le corps médical. Appliquer le mauvais traitement, comme rincer une piqûre de méduse à l’eau douce, ne fait qu’aggraver la situation en faisant éclater les cellules urticantes restantes.
| Animal marin | Mythe à déconstruire | Protocole validé |
|---|---|---|
| Méduse | Uriner sur la piqûre, rincer à l’eau douce, frotter avec du sable. | Rincer abondamment à l’eau de mer (ou au vinaigre). Retirer les tentacules visibles avec une pince ou le bord d’une carte rigide, sans frotter. Appliquer du chaud ou du froid pour la douleur. |
| Vive | Inciser la plaie pour la faire saigner, aspirer le venin. | Le venin de vive est thermolabile (détruit par la chaleur). Immerger la zone atteinte dans une eau la plus chaude possible (environ 45°C, sans se brûler) pendant 30 à 90 minutes. Cela neutralise le venin et calme la douleur intense. |
| Oursin | Retirer immédiatement toutes les épines avec une pince, même les plus profondes. | Désinfecter la plaie. Tremper dans de l’eau chaude avec un antiseptique pour ramollir la peau. Retirer uniquement les épines superficielles et accessibles. Les épines profondes se résorberont souvent seules ou seront rejetées par le corps. Tenter de les extraire peut les casser et provoquer une infection. |
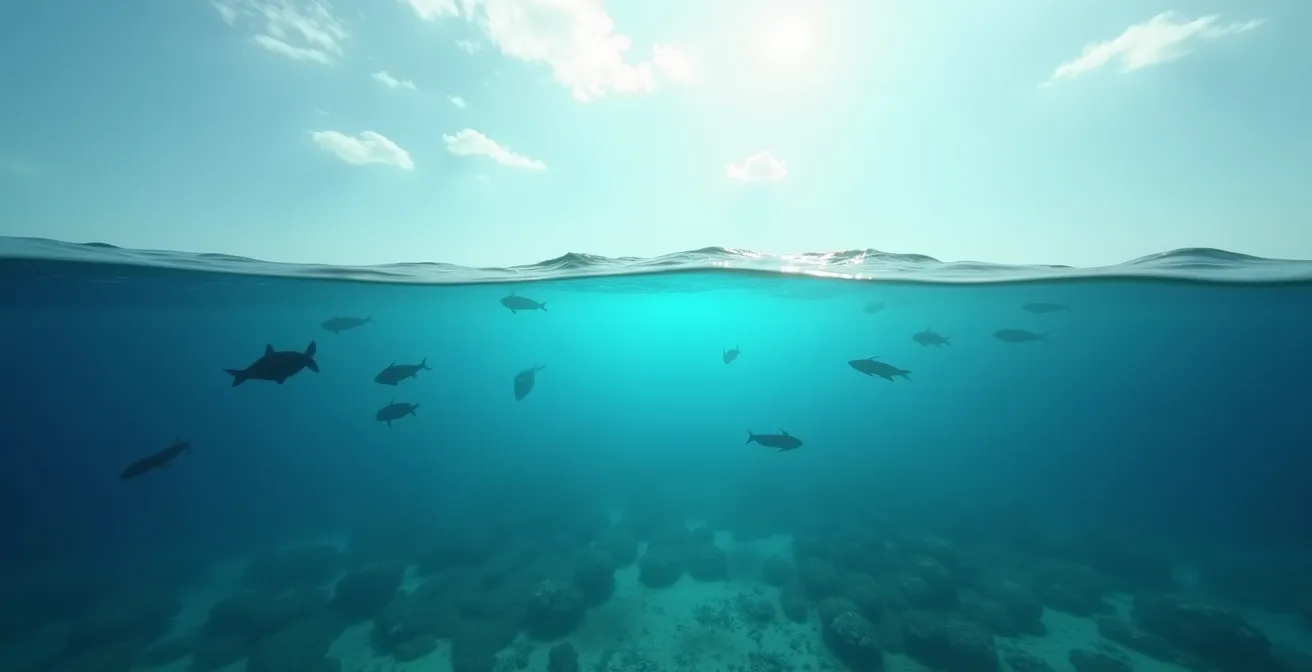
L’environnement marin est un écosystème complexe qu’il convient de respecter. Une bonne connaissance des espèces et des gestes appropriés permet une cohabitation sereine et sécurisée, loin des peurs irrationnelles. Dans tous les cas, après les premiers soins, il est crucial de bien désinfecter et de surveiller l’apparition de signes d’infection (rougeur, chaleur, gonflement) ou de réaction allergique, qui nécessitent un avis médical.
Une trousse de secours bien rangée est une urgence à moitié gérée
Dans le chaos d’une urgence, chaque seconde compte. Une trousse de secours qui est un simple fourre-tout devient un facteur de stress supplémentaire. Chercher frénétiquement une compresse pendant qu’un équipier saigne est une perte de temps critique. L’organisation de votre matériel médical n’est pas une coquetterie, c’est une composante essentielle de la rapidité et de l’efficacité de votre intervention. La meilleure approche est de penser en trousse modulaire.
L’idée est de ne pas ranger par type de produit (tous les pansements ensemble, tous les médicaments ensemble), mais par type d’intervention. Créez des pochettes ou des sacs de congélation étanches et clairement identifiés : « HÉMORRAGIE », « BRÛLURE », « MALAIS », « PETITE PLAIE ». Ainsi, face à une coupure grave, vous saisissez le module « HÉMORRAGIE » qui contient tout le nécessaire : gants, compresses, pansement compressif, garrot. Cette méthode évite d’avoir à réfléchir et chercher.
Pour aller plus loin, adoptez le principe de la double trousse :
- Une trousse d’intervention rapide : Petite, étanche, voire flottante, elle contient le matériel pour les urgences vitales (hémorragie, malaise). Elle doit être immédiatement accessible dans le cockpit.
- Une pharmacie principale : Plus complète, elle contient le reste du matériel, les médicaments, et le stock de renouvellement. Elle peut être rangée à l’intérieur du bateau.
Enfin, pour optimiser la gestion, reconditionnez les produits. Sortez les médicaments de leurs boîtes en carton (qui prennent l’humidité) pour les placer dans des sacs zip avec la notice et un sachet de gel de silice. Une checklist plastifiée du contenu, avec des photos et les dosages, est un aide-mémoire précieux dans le feu de l’action.
Votre plan d’action pour auditer votre trousse de secours
- Inventaire exhaustif : Videz intégralement votre trousse. Listez chaque produit et vérifiez sa date de péremption. Jetez sans hésiter tout ce qui est périmé, ouvert ou endommagé par l’humidité.
- Analyse des manques : Comparez votre inventaire avec la liste des 10 ajouts essentiels (module diagnostic, hémorragie, etc.). Identifiez précisément ce qui vous manque pour gérer les syndromes graves.
- Création des modules : Procurez-vous des pochettes étanches ou des sacs zip robustes. Regroupez le matériel par syndrome d’intervention (Hémorragie, Brûlure, Malaise, etc.) et étiquetez chaque module de manière visible.
- Optimisation du conditionnement : Sortez les médicaments et compresses de leurs emballages en carton. Reconditionnez-les dans des sacs zip individuels avec leur notice et un sachet déshydratant.
- Mise en place de la checklist : Créez un document plastifié avec la liste complète du contenu de chaque module, incluant les dosages principaux (adulte/enfant). Attachez-le à l’intérieur de la trousse principale.
Vous n’êtes pas seul : comment bénéficier d’une consultation avec un médecin urgentiste 24h/24
Même le chef de bord le plus préparé et le mieux formé atteint ses limites. Face à une situation qui le dépasse ou un doute sur la conduite à tenir, il existe un maillon essentiel de la chaîne de secours en mer : le Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM). Basé à Toulouse, ce service gratuit est composé de médecins urgentistes disponibles 24h/24 et 7j/7 pour conseiller les navires du monde entier. Ils sont le cerveau médical déporté de votre bateau.
Leur rôle est crucial, et ne pas les solliciter est une faute. Ils vous guideront dans l’évaluation de la victime, dans la réalisation des gestes et dans l’administration d’éventuels médicaments de votre pharmacie de bord. C’est sur la base de leur diagnostic à distance que le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) décidera ou non de déclencher une évacuation sanitaire. Les 15 000 sauvetages en mer coordonnés par les CROSS chaque année en France montrent l’importance de ce dispositif.
Pour que cet échange soit efficace, votre appel doit être structuré. C’est là qu’intervient le protocole MIST, un acronyme simple pour transmettre un bilan clair et complet :
- M – Mechanism (Mécanisme) : Décrivez précisément les circonstances de l’accident ou du malaise. (Ex: « Chute depuis le mât », « Malaise brutal après effort »).
- I – Injury (Blessures) : Détaillez les blessures ou symptômes observés. (Ex: « Plaie ouverte et saignement important à l’avant-bras droit », « Pâleur extrême et sueurs »).
- S – Signs (Signes) : Communiquez les constantes vitales que vous avez pu mesurer. C’est ici que l’oxymètre et le tensiomètre prennent toute leur valeur. (Ex: « Pouls à 120/min, saturation en oxygène à 92% »).
- T – Treatment (Traitement) : Indiquez les soins que vous avez déjà prodigués. (Ex: « Pose d’un pansement compressif, victime allongée »).
Contacter les secours se fait prioritairement par VHF sur le canal 16 en lançant un « PAN PAN » (urgence médicale) ou un « MAYDAY » (détresse vitale). Si vous avez une couverture réseau, vous pouvez contacter directement le CCMM pour une consultation médicale au +33 (0)5 34 39 33 33. Ce numéro doit être affiché en permanence à votre table à cartes.
Points clés à retenir
- La compétence prime sur l’équipement : une formation PSC1 est plus précieuse que la trousse la plus chère.
- Pensez en « syndromes » (hémorragie, malaise) et organisez votre matériel en modules d’intervention pour une action rapide.
- Maîtrisez les protocoles pour les urgences spécifiques (garrot, retrait d’hameçon, choc thermique pour piqûre de vive) car les remèdes de grand-mère sont dangereux.
Votre équipement de sécurité : des objets inutiles qui prennent la poussière ou vos meilleurs alliés en cas de crise ?
Un gilet de sauvetage dernier cri, une balise de détresse flambant neuve, une trousse de secours complète… Votre bateau est peut-être rempli d’équipements de sécurité coûteux. Mais si vous ne les avez jamais testés, si vous ne savez pas instinctivement où ils se trouvent et comment ils fonctionnent, ils ne sont que du poids mort et une fausse assurance. En situation de crise, la mémoire musculaire et la connaissance intime de son matériel sont les seuls véritables alliés.
L’équipement de sécurité ne devient un allié qu’à deux conditions : il doit être en parfait état de fonctionnement et son utilisation doit être un réflexe pour tout l’équipage. Cela implique une discipline rigoureuse. Avant chaque sortie, une vérification rapide du matériel critique s’impose. La pharmacie de bord est particulièrement vulnérable à l’environnement marin ; l’humidité et les variations de température dégradent les produits bien plus vite qu’à terre. Il est donc crucial de vérifier le contenu de votre trousse et les dates de péremption du matériel avant chaque départ.
L’autre pilier est l’entraînement. Comme le souligne ce retour d’expérience d’un plaisancier aguerri, posséder le matériel ne suffit pas :
Vous avez une trousse de premier secours pour bateau complète et à jour, c’est une bonne chose mais cela ne servirait presque à rien si vous ne savez pas quoi faire en cas d’accident ! Quand on part en mer, loin de tout, ce n’est pas comme si on pouvait appeler les pompiers pour qu’ils arrivent cinq minutes plus tard ! Il faut savoir se débrouiller !
– Un plaisancier expérimenté, Nautisme-Pratique.com
Organisez régulièrement des exercices avec votre équipage. Simulez un « homme à la mer », un départ de feu, ou une blessure. Qui fait quoi ? Où est l’extincteur ? Comment percuter le gilet de sauvetage ? Qui prend la barre ? Qui contacte le CROSS ? Ces simulations, même courtes, ancrent les procédures et révèlent les failles de votre organisation. C’est par cette préparation active que des objets qui prennent la poussière se transforment en vos meilleurs alliés en cas de crise.
L’étape suivante consiste donc à planifier dès maintenant votre prochaine formation aux premiers secours et à organiser une session d’audit et d’entraînement avec votre équipage. La sécurité en mer n’est pas une destination, mais un processus d’amélioration continue.